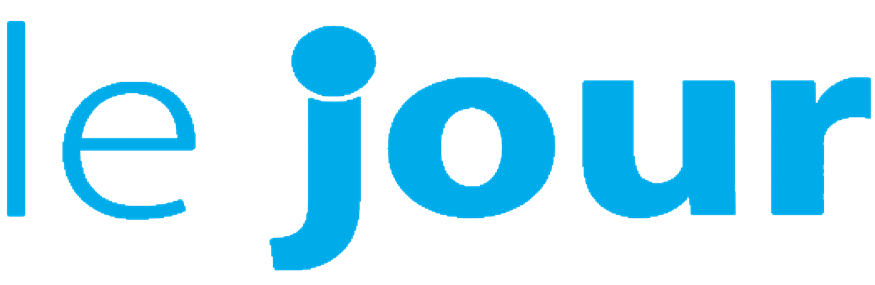La salle des conférences du Goethe Institut a accueilli près d’une vingtaine de journalistes le vendredi 31 mars. Le menu du jour était l’atelier de formation sur le fact-checking (vérification des faits) et l’intelligence artificielle. C’est la toute première formation en fact-checking spécialisée organisée à Yaoundé. Elle se tient dans un contexte où les réseaux sociaux sont pollués d’informations erronées et de contenus montés de toute pièce (Photos montées, rumeurs, gags). « La formation a été initiée pour permettre aux journalistes de faire face aux défis actuels de ce métier en étant suffisamment outillés », explique Elsa Kane, project manager de la formation. « L’accent a été mis sur la culture, parce que comme la politique ou la santé, elle n’est pas épargnée par la désinformation. On se rappelle encore des rumeurs sur la mort d’artistes comme Ekambi Brillant, Marthe Zambo, Ahidjo Mamadou et bien d’autres », souligne la journaliste.
Lire aussi : Patrimoine : Rendez-vous au Nja’Nja M’ndzang
Durant ce premier atelier, les journalistes ont eu droit à de nombreux thèmes. « Comment traquer les fake news dans le domaine culturel » et « comment repérer les montages de l’intelligence artificielle » étaient les premiers. Ils ont été développés de manière théorique et démontrés de manière pratique par Monique Ngo Mayag, journaliste fact-checker à l’Agence France-Presse (AFP) à Dakar. « Les images du pape arborant un look de rappeur américain ou des photos de son mariage sont quelques exemples d’images générées de manière artificielle », indique la journaliste qui intervenait par vidéo-conférence.
Ces images qui semblent réalistes ont des anomalies et des incohérences. «L’intelligence artificielle a encore du mal à générer les reflets, les mains sont souvent déformées et on constate des asymétries sur certaines parties du corps. Il est important d’être attentif ». Aussi, la journaliste fact-checker a donné quelques indices de repérage de désinformation. « Les messages qui circulent via WhatsApp et Facebook avec des contenus tels que Alerte, urgent ou partager massivement sont des éléments qui sont destinés à susciter la peur et rendre l’information virale. Ce sont des informations erronées ».
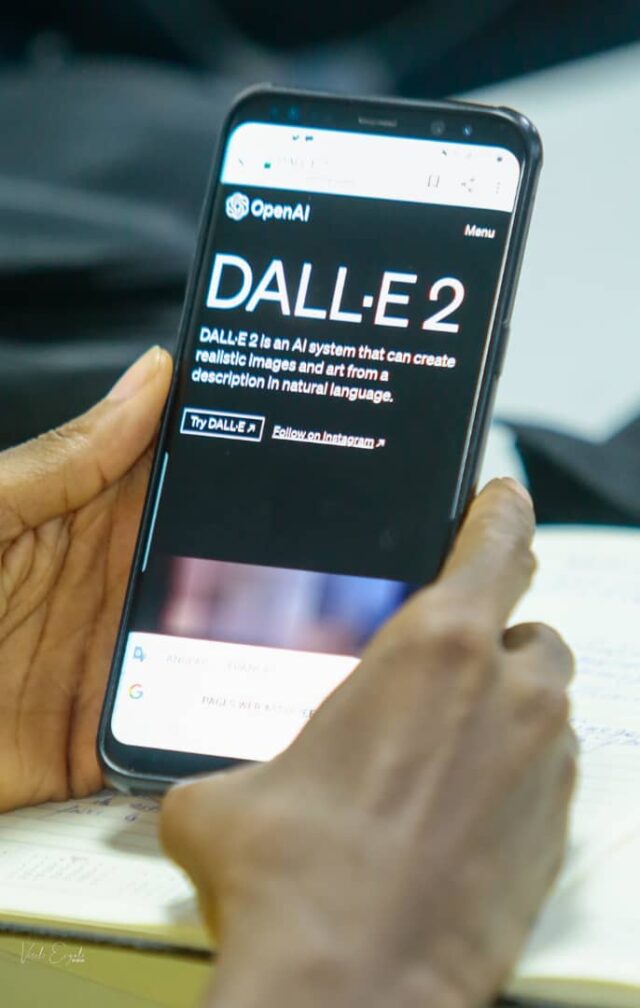
Lire aussi : Le cinéma, une arme solide pour l’essor du continent africain
Un journaliste qui cesse d’apprendre est comme un enseignant qui meurt dit-on. La deuxième partie de cet atelier était axée sur « les outils de recherches et techniques de rédaction d’un article de fact-checking », animée par La fact-checker à Stop Blablacam, Patricia Ngo Ngouem. Les fausses informations s’accompagnent d’illustrations trafiquées ou détournées dont il est désormais possible de vérifier l’origine grâce à des techniques de recherches. « La recherche d’images inversées permet de trouver les informations sur une image ou sa source sur internet en l’insérant dans un moteur de recherche tels que Google Lens, bing, yandex,…», développe Patricia Ngo Ngouem. Il est important de démasquer la fausse information mais encore plus de savoir expliquer le procédé qui l’a permis et ce de manière méthodique pour sensibiliser les lecteurs. « La méthodologie de rédaction d’un article de vérification de faits diffère d’un site de fact-checking à l’autre mais à le même objectif ; celui d’aider le lecteur à comprendre le processeur qui a conduit à démêler le vrai du faux ».
Le troisième pan de l’atelier a été animé par Laure Nganlay et Giyo Ndzi, journalistes. Ils ont tous deux sensibilisé leurs confrères sur le danger des discours haineux en ligne en leur dévoilant quelques axes de solutions. Signaler les pages qui excitent le discours haineux ; éduquer les leaders d’opinion, les blogueurs et les dirigeants sur les dangers d’une telle communication, …
Hilary Sipouo (stagiaire)