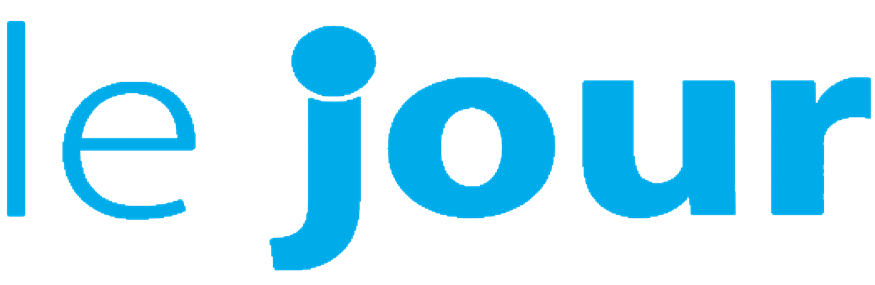Chaque année, cette complication grave fait de nombreuses victimes en raison de la difficulté d’accéder à un traitement approprié.
Pendant près de trois mois, les urines ont coulé sans cesse sur le corps de Rochelle (nom d’emprunt), dégageant une odeur persistante que nul ne pouvait ignorer. L’humiliation était devenue son lot quotidien. À la maison, une chaise spéciale recouverte d’une housse lui avait été attribuée, signe tangible de son isolement après la séparation avec son compagnon. « Je suis retournée vivre dans ma famille », confie-t-elle, les traits tirés et le regard chargé de tristesse. Après avoir tenté en vain diverses recettes dites « de grand-mère », elle finit par briser le silence. À l’hôpital, elle se heurte à l’incompréhension : « Nous ne comprenions plus rien. C’est ma mère, pleine de compassion, qui m’a encouragée à retourner à l’hôpital où j’avais accouché, pensant que ce n’était qu’un problème d’hygiène. »
Puis le verdict tomba, brutal : fistule obstétricale. « C’est quoi, ce truc ? » se souvient-elle avoir lancé, submergée par l’angoisse et la confusion. Les mots du médecin lui paraissaient absurdes, presque irréels. Son médecin lui avait expliqué méthodiquement ce que le Dr Véronique Mboua Batoum, gynécologue et intervenante lors du café presse scientifique organisé par l’Association des Résidents et Internes de Gynécologie Obstétrique du Cameroun (Arigoc), a mis en lumière à l’occasion de la Journée mondiale pour l’élimination des fistules obstétricales, célébrée tous les 23 mai : la fistule obstétricale est une complication grave résultant d’un accouchement difficile ou prolongé, caractérisée par la formation d’un passage anormal entre le vagin et la vessie et/ou le rectum, par lequel l’urine et/ou les matières fécales fuient constamment, créant l’incontinence (Perte involontaire d’urine ou de matières fécales).
Petit bassin, gros bébé, système de santé défaillant…
La rencontre qui s’est tenue sous l’égide de la doyenne de la Faculté de médecine et de sciences biomédicales de l’Université de Yaoundé I et du Pr Pierre Marie Tebeu, a permis d’aborder tous les aspects de cette complication grave à la fois taboue et négligée. Les facteurs de risque des fistules obstétricales sont nombreux et inquiétants. Parmi eux figurent la petite taille du bassin, le faible poids de la mère, la multiparité, l’accouchement précoce, le mariage précoce, la pauvreté qui empêche les femmes de consulter ou d’avoir accès à des soins médicaux adéquats, un suivi gynécologique irrégulier et inadéquat, le manque de connaissances, la mutilation génitale féminine et l’accès difficile aux services de planification familiale. Selon la gynécologue et ses pairs, il existe trois causes principales de fistules, à savoir : les causes obstétricales dues à un travail prolongé et obstructif, les déchirures périnéales et enfin, les causes iatrogènes qui résultent d’interventions médicales telles que la césarienne et le retrait manuel du placenta. En fait, les experts estiment que 90,4 % à 92,2 % des fistules génitales féminines sont liées à l’accouchement et aux déchirures directes des tissus.
Dans le cas de Rochelle, l’accouchement d’un bébé de 5,3 kg a entraîné des complications en raison de l’étroitesse de son bassin, ce qui a provoqué une fistule obstétricale. Elle n’est pas seule dans cette situation, car chaque jour, environ 800 femmes meurent des complications liées à la grossesse ou à l’accouchement dans le monde entier. Pour chaque femme qui meurt des causes liées à la maternité, on estime qu’au moins vingt sont atteintes de morbidité maternelle, dont l’une des formes les plus sévères et humiliantes est la fistule obstétricale, selon les Nations unies. Par conséquent, chaque année, on dénombre entre 50 000 et 100 000 nouveaux cas de fistule obstétricale dans le monde. Selon l’Enquête démographique et de santé de 2018, environ 17 221 femmes souffrent de fistules obstétricales non traitées au Cameroun. De plus, d’après l’Enquête à indicateurs multiples par grappe réalisée en 2014, la prévalence de la fistule obstétricale est estimée à 20 000 cas, avec une incidence de 2 000 nouveaux cas chaque année. La région du Centre, par exemple, enregistre entre 35 et 210 nouveaux cas chaque année. En 2021, le ministère de la Santé publique du Cameroun a rapporté 20 000 cas de fistules obstétricales.
La situation est alarmante, car au cœur de ce problème se trouve la défaillance du système de santé… Comment ? Les spécialistes de la santé, en l’occurrence les gynécologues, soulignent que la mauvaise gestion des accouchements, caractérisée par un suivi insuffisant des femmes en travail et une surveillance inappropriée des contractions, contribue à ces complications. Par ailleurs, le manque de personnel soignant qualifié aggrave la situation, car la charge de travail excessive pousse souvent le personnel à précipiter les décisions, entraînant ainsi des erreurs et des complications.
Bien que la fistule obstétricale puisse être réparée par une opération, il est important de noter que celle-ci ne réussit pas toujours. Le Pr Claude Cyrille Noa Ndoua, agrégé de gynécologie-obstétrique, a souligné l’importance de l’expertise chirurgicale en présentant les différentes options disponibles : « La réparation d’une fistule demande expertise et rigueur. Chaque cas est unique. Il faut identifier la localisation, la taille et la complexité. Les soins post-opératoires sont aussi importants que l’acte chirurgical lui-même pour prévenir les récidives. » Il a également précisé les principes chirurgicaux fondamentaux, tels que l’excision du tissu nécrosé, la fermeture étanche des organes, la mobilisation de tissus sains et, dans certains cas, l’interposition de lambeaux pour renforcer la zone réparée. En résumé, selon les classifications de l’OMS, les fistules obstétricales peuvent être simples ou complexes, et leur traitement nécessite un plateau technique et une expertise que peu de centres maîtrisent entièrement.
Infertilité, séparations, isolement…
Après une première intervention chirurgicale qui a échoué à cause du décollement précoce des points de suture, Rochelle a dû subir une seconde opération lors d’une campagne médicale au Centre hospitalier universitaire de Yaoundé (Chuy). Cette fois, l’intervention a porté ses fruits. « Aujourd’hui, je peux raconter mon histoire sans larmes, même si le père de mon enfant est parti », témoigne-t-elle avec sérénité. Le Pr Élie Nkwabong, chef du service de gynécologie-obstétrique au Chuy, insiste sur la portée de ces actes médicaux. « Chaque femme réparée est une victoire », confie-t-il. « Ce sont elles les vectrices du changement. Briser le silence, c’est reconnaître leur humanité. Restaurer la dignité, c’est accompagner leur renaissance. » Mais lorsqu’une réparation échoue, ou que l’accès aux soins n’est pas possible, les répercussions peuvent être dramatiques. Elles vont des infections urinaires ou vaginales à l’incontinence chronique, en passant par l’infertilité secondaire, des atteintes rénales, des grossesses compliquées… sans oublier les effets dévastateurs sur la vie personnelle : malnutrition, dépression, ruptures conjugales et perte d’emploi.
Aïcha, 19 ans, partage son vécu avec une lucidité douloureuse : « Au début, j’étais une épouse et une mère. Depuis ce problème, on m’a surnommée « la femme qui sent mauvais ». Mon mari m’a abandonnée. » Ce témoignage illustre parfaitement les conséquences dévastatrices de la fistule obstétricale sur la vie des femmes. L’infirmière Magne Henriette Simo, spécialiste en santé de la reproduction et doctorante à l’Université catholique d’Afrique centrale, explique que la fistule obstétricale inflige bien plus qu’une lésion physique. Elle provoque également des blessures psychologiques et sociales profondes. Selon elle, même après une chirurgie réussie, bon nombre de survivantes continuent de vivre dans l’ombre, marquées par l’isolement, la pauvreté et la stigmatisation. Face à ces réalités, elle plaide pour une approche globale centrée sur la reconstruction des femmes : les accueillir avec dignité, entendre leur récit et les reconnaître comme actrices de leur propre réinsertion sociale et économique. Elle cite une étude menée à l’hôpital Jean-Paul II de Conakry (Guinée), qui met en lumière les obstacles que rencontrent les femmes lors de leur retour dans la communauté post-chirurgie. Une autre étude, réalisée au Kenya en 2015, confirme ces constats et insiste sur l’importance d’un soutien global psychologique, familial et économique pour accompagner leur renaissance.
L’urgence d’un accès équitable aux soins
Même s’il faut pour les experts repousser l’âge de la première grossesse et mettre fin aux pratiques traditionnelles préjudiciables, permettre aux femmes d’avoir accès en temps voulu à des soins obstétricaux est une nécessité absolue pour prévenir la fistule obstétricale, car pour eux, la fistule obstétricale demeure une complication grave évitable, révélatrice des inégalités en matière de santé. À cet égard, le Dr William Zambo Zambo, président de l’Association des Résidents et Internes de Gynécologie Obstétrique du Cameroun, souligne : « Ces cas traduisent une profonde inégalité d’accès aux soins. Il est urgent d’agir : améliorer la qualité des services obstétricaux, sensibiliser les jeunes filles et combattre les inégalités structurelles. » En complément, le Dr Nathalie Nkoue ajoute : « Une femme qui accouche à l’hôpital doit bénéficier d’un suivi rigoureux. Les médecins doivent s’assurer qu’elle quitte l’établissement après une consultation post-partum complète. Il est impératif que toutes les femmes accouchent dans des structures offrant une prise en charge adaptée et un accompagnement de qualité. »
Dans ce contexte, il existe au Cameroun le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa), engagé depuis 2003 à améliorer l’accès aux accouchements assistés et aux soins obstétricaux d’urgence. Ses initiatives incluent, en collaboration avec le gouvernement camerounais à travers le ministère de la Santé publique, la formation et le déploiement de sages-femmes et d’agents de santé, l’offre de soins chirurgicaux lors de campagnes gratuites, ainsi que du soutien psychosocial et de réinsertion économique. De plus, des efforts de sensibilisation sont menés pour réduire la stigmatisation. C’est dans ce cadre qu’une campagne de réparation des fistules obstétricales a eu lieu du 7 au 27 juin 2025 à l’hôpital régional de Maroua et à l’annexe de Mokolo. Initialement prévue pour 100 femmes, 105 survivantes ont finalement bénéficié d’opérations gratuites.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du 8e programme de coopération entre le gouvernement et l’Unfpa, visant à augmenter les accouchements assistés et à prévenir de nouveaux cas. La campagne a également inclus une « cérémonie du pagne » pour symboliser le retour à la vie communautaire des femmes opérées, ainsi qu’un accompagnement personnalisé pour la mise en place d’activités génératrices de revenus. Cette approche holistique a permis la guérison physique et la reconstruction d’une vie digne. À ce jour, le Cameroun réalise en moyenne 200 opérations chirurgicales par an et rend autonomes 300 femmes traitées pour fistules obstétricales grâce à des activités génératrices de revenus. Ainsi, à travers sa collaboration avec le ministère de la Santé publique, l’Unfpa renforce son plaidoyer pour mettre fin à la fistule obstétricale au Cameroun, appelant à un engagement accru et à une allocation de ressources futures de la part du gouvernement, de ses partenaires et des donateurs.