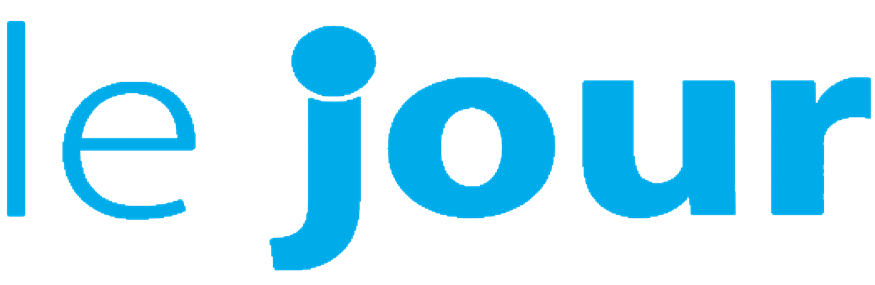Par : Diane Audrey Ngako
Je n’écris pas ces lignes pour convaincre, encore moins pour dénoncer, mais parce que j’aime ce pays et qu’à la veille de la proclamation des résultats, j’ai peur pour lui. Depuis des semaines, le Cameroun retient son souffle. Les conversations sont feutrées, les regards inquiets, les certitudes rares. Chacun pressent que quelque chose se joue, peut-être même plus grand que le nom qui sortira des urnes. Ce moment n’est pas seulement politique, il est moral, presque spirituel. C’est une épreuve de vérité : celle d’un peuple qui, depuis trop longtemps, survit plus qu’il ne vit.
Nous arrivons à cette étape de notre Histoire comme on arrive au bout d’un long voyage sans boussole : fatigués, méfiants, parfois résignés. Le pays est fracturé, non seulement politiquement, mais aussi moralement, socialement et générationnellement. Chaque crise a laissé une cicatrice et chaque blessure un silence. En 1955, la peur est devenue un langage politique. L’insurrection de l’Union des Populations du Cameroun, menée par Ruben Um Nyobè, Félix-Roland Moumié et Ernest Ouandié, fut noyée dans le sang. Des villages entiers ont été brûlés, des familles décimées, et la répression coloniale a ancré durablement la peur comme mode de gouvernance. Ce traumatisme fondateur a façonné notre rapport à l’État : la peur comme ciment, la méfiance comme héritage.
En 1984, c’est la confiance nationale qui s’est brisée. Une partie de la Garde Républicaine, restée fidèle à Ahmadou Ahidjo, a tenté un coup d’État contre le président Paul Biya. La répression fut d’une extrême violence et le pays s’est refermé sur lui-même, dans un climat de suspicion où chaque région, chaque nom, chaque accent pouvait devenir un signe d’allégeance. Depuis, l’armée n’est plus seulement une institution républicaine, elle est devenue un instrument de contrôle politique. Le Bataillon d’Intervention Rapide (BIR), unité d’élite considérée comme la garde prétorienne du président, est aujourd’hui formé et conseillé par des experts israéliens. Ce fait, souvent tu, traduit une dépendance sécuritaire qui dit beaucoup d’un régime ayant appris à craindre son propre peuple plus qu’à le protéger.
En 1992, c’est l’espoir démocratique qui s’est éteint. Après les “villes mortes”, les grèves et l’élan citoyen qui avaient précédé les premières élections pluralistes, les Camerounais ont cru à une alternance possible. Mais la victoire fut confisquée, et la déception, immense. Beaucoup ont compris ce jour-là que la voix du peuple pouvait être étouffée, que la démocratie pouvait être un théâtre, et que le vote ne suffisait pas toujours à changer le réel. Depuis, le scepticisme s’est enraciné, et une génération entière a grandi dans l’idée que tout est joué d’avance.
Et puis, en 2017, la crise anglophone a rappelé que nos fractures ne sont pas seulement politiques, mais aussi territoriales et identitaires. Les revendications sociales et culturelles se sont transformées en conflit armé, laissant derrière elles des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Ce drame a ravivé l’urgence d’un vrai dialogue, d’une reconnaissance des blessures et d’une réconciliation sincère.
Nous voici en 2025, encore à la croisée des chemins. Entre mémoire et avenir, entre fatigue et désir de changement, le pays s’interroge sur ce qu’il est devenu et sur ce qu’il veut encore être. Les premiers chiffres, ceux partagés par de nombreux bureaux de vote, laissent penser qu’Issa Tchiroma Bakary aurait remporté ce scrutin. Mais au Cameroun, l’expérience enseigne que les chiffres officiels et la vérité des urnes ne se confondent pas toujours. Ce doute permanent sur la sincérité du vote abîme la foi citoyenne et nourrit la peur d’un nouveau déni démocratique.
Ce qui m’inquiète aujourd’hui n’est pas seulement l’issue du vote, mais ce qu’elle dit de nous. Nous sommes devenus un peuple qui doute de sa propre capacité à choisir, un peuple qui craint autant le changement que la continuité, un peuple qui, face à la peur, se replie, s’isole ou s’en remet à la fatalité. L’insécurité n’est plus seulement politique, elle est intime. Chacun sauve ce qu’il peut : son emploi, sa dignité, sa paix.
Pourtant, au milieu du bruit et du désenchantement, je continue de croire qu’un pays ne se défait pas en un jour. Le Cameroun n’est pas qu’un régime, qu’un scrutin ou qu’un affrontement d’ambitions. C’est une promesse encore inachevée. C’est un peuple de patience et de fierté, de courage et de lucidité, de tendresse et de colère. C’est surtout une jeunesse debout, consciente, inventive, qui ne se contente plus d’observer, mais qui crée, entreprend, s’organise. Elle invente d’autres façons d’habiter le pays, de penser la politique, de transformer le réel. Elle refuse d’attendre qu’on lui tende la main : elle tend la sienne vers l’avenir. Nelson Mandela disait : « Aux jeunes d’aujourd’hui, j’ai un vœu à faire : soyez les scénaristes de votre destin et présentez-vous comme des étoiles qui montrent la voie vers un avenir meilleur. »
À la veille de la proclamation des résultats, mon vœu est que cette jeunesse prenne la plume, la parole et la place qui lui reviennent, et que chacun, à son niveau, accepte de tisser un morceau du lien national. Tisser, c’est rouvrir les espaces de dialogue entre nos régions, c’est repenser l’éducation civique et la mémoire collective, c’est réhabiliter la vérité dans nos institutions et la confiance dans nos débats. Tisser, c’est bâtir des ponts entre ceux qui partent et ceux qui restent, entre ceux qui gouvernent et ceux qui subissent, entre la peur d’hier et la promesse de demain.
Parce qu’au fond, ce pays n’a pas besoin d’un sauveur. Il a besoin d’un tisserand collectif, d’un effort commun pour recoudre ce qui a été déchiré. Ce tisserand, ce n’est pas un homme, ni une femme. C’est nous.
*Entrepreneure et citoyenne engagée, fondatrice du groupe Akéde, et membre fondatrice du think do tank The Okwelians, qui œuvre à promouvoir, par le leadership éthique, une culture d’innovation sociale au Cameroun.